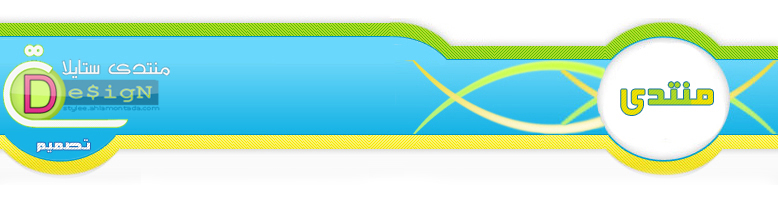français est une langue romane. Sa grammaire et la plus grande partie de son vocabulaire sont issues des formes orales et populaires du latin, telles que l’usage les a transformées depuis l’époque de la Gaule romaine. Les Serments de Strasbourg, qui scellent en 842 l’alliance entre Charles le Chauve et Louis le Germanique, rédigés en langue romane et en langue germanique, sont considérés comme le plus ancien document écrit en français.
Au Moyen Âge, la langue française est faite d’une multitude de dialectes qui varient considérablement d’une région à une autre. On distingue principalement les parlers d’oïl (au Nord) et les parlers d’oc (au Sud). Avec l’établissement et l’affermissement de la monarchie capétienne, c’est la langue d’oïl qui s’impose progressivement.
Mais on peut dire que la France est, comme tous les autres pays d’Europe à cette époque, un pays bilingue : d’une part, la grande masse de la population parle la langue vulgaire (ou vernaculaire), qui est aussi celle des chefs-d’œuvre de la littérature ancienne (la Chanson de Roland, le Roman de la rose...) ; d’autre part, le latin est la langue de l’Église, des clercs, des savants, de l’enseignement, et c’est aussi l’idiome commun qui permet la communication entre des peuples aux dialectes plus ou moins bien individualisés.
Malgré la progression continue du français, cette coexistence se prolonge jusqu’au XVIIe siècle, et même bien plus tard dans le monde de l’Université et dans celui de l’Église.
’extension de l’usage du français (et, qui plus est, d’un français qui puisse être compris par tous) est proportionnelle, pour une large part, aux progrès de l’administration et de la justice royales dans le pays. Inversement, l’essor de la langue française et la généralisation de son emploi sont des facteurs déterminants dans la construction de la nation française.
Deux articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier en août 1539, donnèrent une assise juridique à ce processus :
Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de justice, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait, ni puisse avoir, aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à demander interprétation.
Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel français et non autrement.
Ainsi la vie publique du pays était-elle indissociablement liée à l’emploi scrupuleux (afin de ne laisser « aucune ambiguïté ou incertitude ») du « langage maternel français ». Ce texte fondateur doit être rapproché de la Deffence et Illustration de la langue françoyse (1549). Le manifeste du groupe qu’on appellera plus tard la « Pléiade » proclame, exactement dix ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts, l’excellence et la prééminence du français en matière de poésie. On le voit, l’attachement résolu à la langue française répond à une exigence à la fois politique, juridique et littéraire.
C’est la même exigence qui conduit à la création de l’Académie française en 1635. Selon les termes de Marc Fumaroli, Richelieu a fondé l’Académie pour « donner à l’unité du royaume forgée par la politique une langue et un style qui la symbolisent et la cimentent ». Ainsi, l’article XXIV des statuts précise que « la principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ».
Le dispositif imaginé par Richelieu était si parfait qu’il a franchi les siècles sans modification majeure : le pouvoir politique ne saurait sans abus intervenir directement sur la langue ; il laisse donc à une assemblée indépendante, dont le statut est analogue à celui des cours supérieures, le soin d’enregistrer, d’établir et de régler l’usage. En matière de langage, l’incitation, la régulation et l’exemple sont des armes bien plus efficaces que l’intervention autoritaire.
L’éclat et la puissance de la monarchie française, le raffinement de la culture, les perfectionnements apportés à la langue par l’Académie et les grammairiens, l’influence non négligeable des populations protestantes émigrées, font que le français déborde rapidement, aux XVIIe et XVIIIe siècles, le cadre de la nation. C’est la langue de l’aristocratie et des personnes cultivées dans tout le Nord de l’Europe, en Allemagne, en Pologne, en Russie... C’est aussi la langue de la diplomatie. Tous les grands traités sont rédigés en français, alors qu’ils l’étaient auparavant en latin. L’empire de la langue française dépasse largement (et c’est une constante) l’empire politique et économique de la France.
epuis la première édition du Dictionnaire de l’Académie, qui représentait déjà un effort normatif sans précédent, l’orthographe s’est considérablement transformée, tant du fait d’une évolution naturelle que par l’intervention raisonnée de l’Académie, des lexicographes et des grammairiens. La réflexion sur l’orthographe doit tenir compte de données multiples et souvent contradictoires, comme le poids de l’usage établi, les contraintes de l’étymologie et celles de la prononciation, les pratiques de l’institution scolaire, celles du monde des éditeurs et des imprimeurs, etc.
L’Académie s’est employée, tout au long de son histoire, à maintenir un équilibre entre ces différentes exigences, l’expérience prouvant que les projets abstraits des réformateurs ne sauraient à eux seuls faire plier l’usage. Ainsi adopta-t-elle en 1835, dans la sixième édition de son Dictionnaire, l’orthographe -ais pour les mots terminés jusqu’alors en -ois mais prononcés depuis longtemps è (le françois, j’étois, etc.), réforme réclamée au siècle précédent par Voltaire.
Au XIXe siècle, le développement de l’institution scolaire a sans doute contribué à figer quelque peu l’orthographe, tout en suscitant parallèlement de grands projets de réforme. Le système éducatif avait besoin de règles fermes qui pussent être enseignées aux élèves. Au terme de débats passionnés, deux arrêtés fixèrent, en 1900 et 1901, de simples tolérances orthographiques et syntaxiques pour les examens et concours de l’Instruction publique.
En 1990, le Conseil supérieur de la langue française fit paraître au Journal officiel un document intitulé Les rectifications de l’orthographe. Les principales modifications préconisées étaient :
— la soudure d’un certain nombre de noms composés (portemonnaie, pingpong...) ;
— l’harmonisation du pluriel des noms composés avec celui des noms simples (un perce-neige, des perce-neiges, un garde-malade, des garde-malades...) ;
— la possibilité de supprimer certains accents circonflexes sur le i et le u (voute, traitre, paraitre, huitre...) ;
— l’accent grave sur le e quand il est précédé d’une autre lettre et suivi d’une syllabe qui comporte un e muet (évènement, cèleri, sècheresse, règlementaire — comme règlement —, règlementation...)
— l’application des règles usuelles d’orthographe et d’accord aux mots d’origine étrangère (des imprésarios, un diésel, les médias...).
— la rectification de quelques anomalies graphiques (charriot, imbécilité, nénufar, relai...).
Malgré la modération et le bon sens de ces propositions, la presse s’empara du sujet et entretint une querelle passablement artificielle. L’Académie approuva à l’unanimité le document, mais resta fidèle à sa ligne de conduite traditionnelle en demandant que « lesdites recommandations ne soient pas mises en application par voie impérative et notamment par circulaire ministérielle ». Tout en souhaitant « que ces simplifications et unifications soient soumises à l’épreuve du temps », la Compagnie en a adopté un certain nombre dans son Dictionnaire, mentionnant les autres à la fin de l’ouvrage.
Jugeant que la concurrence de l’anglais, même dans la vie courante, représentait une réelle menace pour le français et que les importations anglo-américaines dans notre lexique devenaient trop massives, les autorités gouvernementales ont été amenées, depuis une trentaine d’années, à compléter le dispositif traditionnel de régulation de la langue.
À partir de 1972, des commissions ministérielles de terminologie et de néologie sont constituées. Elles s’emploient à indiquer, parfois même à créer, les termes français qu’il convient d’employer pour éviter tel ou tel mot étranger, ou encore pour désigner une nouvelle notion ou un nouvel objet encore innommés. Ces termes s’imposent alors à l’administration. On ne dit plus tie-break mais jeu décisif, baladeur remplace walkman, logiciel se substitue à software, etc.
En 1975, la loi dite « Bas-Lauriol » rend l’emploi du français obligatoire dans différents domaines, comme l’audiovisuel ou le commerce (publicité, modes d’emploi, factures, etc.), et dans le monde du travail.
Au cours des années 1990, un ensemble législatif plus cohérent et plus complet est mis en place. Un nouvel alinéa est ajouté, le 25 juin 1992, à l’article 2 de la Constitution : La langue de la République est le français.
e fondant sur ce principe, la loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon », élargit les dispositions de la loi de 1975. Le décret du 3 juillet 1996 institue une nouvelle commission générale de terminologie et de néologie ; il étoffe le dispositif d’enrichissement de la langue française, l’accord de l’Académie française devenant indispensable pour que les termes recommandés soient publiés, avec leurs définitions, au Journal officiel. La magistrature morale de l’Académie se trouve ainsi confirmée par le droit, pour le plus grand bénéfice des instances et organismes impliqués dans la défense de la langue française.
n 1984, le Premier ministre crée une « commission de terminologie relative au vocabulaire concernant les activités des femmes ». Le décret indique notamment que « la féminisation des noms de professions et de titres vise à combler certaines lacunes de l’usage de la langue française dans ce domaine et à apporter une légitimation des fonctions sociales et des professions exercées par les femmes ».
L’Académie française, qui n’avait pas été consultée, fait part de ses réserves dans une déclaration préparée par Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss. Elle dénonce en particulier le contresens linguistique sur lequel repose l’entreprise : il convient de rappeler que le masculin est en français le genre non marqué et peut de ce fait désigner indifféremment les hommes et les femmes ; en revanche, le féminin est appelé plus pertinemment le genre marqué, et « la marque est privative. Elle affecte le terme marqué d’une limitation dont l’autre seul est exempt. À la différence du genre non marqué, le genre marqué, appliqué aux êtres animés, institue entre les deux sexes une ségrégation. » Aussi la féminisation risque-t-elle d’aboutir à un résultat inverse de celui qu’on escomptait, et d’établir, dans la langue elle-même, une discrimination entre les hommes et les femmes. L’Académie conteste enfin le principe même d’une intervention gouvernementale sur l’usage, jugeant qu’une telle démarche risque « de mettre la confusion et le désordre dans un équilibre subtil né de l’usage, et qu’il paraîtrait mieux avisé de laisser à l’usage le soin de modifier ».
Une circulaire du Premier ministre recommanda, en 1986, de procéder à la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres dans les textes officiels et dans l’administration. Elle ne fut guère appliquée. Puis, en 1997, certains ministres du gouvernement préconisèrent pour leur compte la forme féminisée « la ministre », ce qui provoqua une nouvelle réaction des académiciens. Dans une circulaire du 6 mars 1998, le Premier ministre constata le peu d’effet du texte de 1986, mais recommanda à nouveau la féminisation « dès lors qu’il s’agit de termes dont le féminin est par ailleurs d’usage courant ». Il chargea la commission générale de terminologie et de néologie de « faire le point sur la question ».
Le rapport de la commission a été remis au Premier ministre en octobre 1998. Il rappelle qu’une intervention gouvernementale sur l’usage se heurterait très vite à des obstacles d’ordre juridique et pratique, et qu’on peut douter, de toute façon, qu’elle soit suivie d’effet. Il établit une nette différence entre les métiers d’une part (où les formes féminines sont depuis toujours en usage et ne posent pas de problème particulier), et les fonctions, grades ou titres d’autre part, qui doivent être clairement distingués de la personne. La fonction ne peut être identifiée à la personne qui l’occupe, le titre à la personne qui le porte, etc. ; pour cette raison, l’utilisation ou l’invention de formes