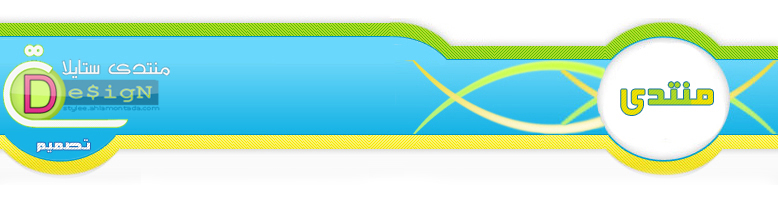[size=18]La situation sociale et pédagogique de la communauté estudiantine algérienne en France se dégrade, à coup sûr, depuis plusieurs années. Les difficultés du train-train quotidien, générées par la crise économique que vit l’Europe, rattrapent violemment nos étudiants. Les problèmes s’entassent et les solutions se font rares, très rares.
Aussi, faut-il dire que l’actuelle législation française risque d’augmenter le taux d’échec annoncé d’intégration universitaire des milliers d’étudiants algériens, pourtant jusque-là exemplaire. En attendant ce que va faire la gauche au pouvoir depuis un peu plus de six mois, les étudiants algériens ne savent plus à quel saint se vouer.
Complètement désavoués, ils sont piégés entre le marteau des projets qui tombent à l’eau et l’enclume d’une réalité dure à vivre, à la limite du supportable. Décryptage:
Parcours du combattant pour tous
Avant d’aller plus loin, rappelons que les quelque 23 000 étudiants algériens, que compte l’ensemble des écoles et universités françaises, ont fait un parcours du combattant avant de pouvoir poser le pied sur le sol français. La procédure de demande de visa d’études est gérée par Campus France Algérie, conjointement avec les services consulaires français.
Ces démarches administratives complexes coûtent à chaque candidat une petite fortune, sans parler d’un tas d’obstacles bureaucratiques. Le pire, certains refont les démarches plusieurs années avant d’avoir «enfin» leur visa. Et ce n’est que le début. Ceux qui ont eu «la chance» d’avoir ce fameux document se heurtent rapidement à une dure réalité. Après un bref moment euphorique où ils découvrent le pays dans lequel ils espèrent relancer leur cursus et construire un avenir meilleur, les premiers traits de déception se font jour. Débarquant dans l’Hexagone avec un visa de trois mois de validité, un étudiant algérien doit, dès son arrivée, entamer d’autres démarches administratives pour les inscriptions pédagogiques à l’université d’accueil, mais aussi pour l’obtention d’un titre de séjour étudiant. La galère commence.
Galère bureaucratique
Tandis que leurs camarades français, européens, latino-américains, orientaux et même maghrébins se concentrent sur le début de l’année universitaire, les étudiants algériens ont d’autres chats à fouetter. Il faut constituer d’abord un dossier pour la demande d’un titre de séjour avec à l’appui un justificatif financier d’un minimum de 5000 euros par an. «Les démarches sont compliquées. Les préfectures sont exigeantes et très lentes dans le traitement des dossiers», témoigne Salem, étudiant à Rennes. Puis, il faut espérer avoir un logement universitaire, car dans le cas contraire c’est un autre parcours du combattan. Il faut trouver un petit abri chez les particuliers, avec tout ce que cela génère comme inconvénients : refus catégorique pour certains favorisant des étudiants d’autres nationalités, l’exigence qu’une tierce personne signe un acte de garantie dit «acte de caution solidaire», le dépôt obligatoire d’une caution financière, mais surtout les prix de loyer élevés qui varient selon l’offre proposée (à partir de 350 euros par mois, toutes charges comprises, pour un petit studio décent dans les régions provinciales et pas moins de 500 euros pour la même offre dans la région parisienne). A défaut d’avoir quelqu’un chez qui s’abriter temporairement, le temps de trouver quelque chose, les provinciaux font la navette vers Paris qui reste la solution idéale pour tous. Cela pour des raisons logiques, en l’occurrence la forte présence de la communauté algérienne. Entre-temps un semestre est déjà écoulé sans avoir vraiment l’opportunité de suivre les cours, séchés pour la plupart.
Travail à «la sauvette» !
Après plusieurs semaines de dépenses et sans revenu, le porte-monnaie de nos étudiants s’épuise. Désormais, la priorité est de trouver un petit job d’étudiant, chose qui est tout sauf évidente. «Après six mois de démarches administratives et de recherche d’emploi, j’ai été engagé par une boîte d’intérim pour travailler, sur des heures décalées, dans une usine de montage automobile. Mais à cause de la crise, on a mis fin à mon contrat en juillet dernier. Depuis, je suis à la recherche d’un emploi», raconte Salem, sachant qu’il doit, en même temps, préparer son mémoire de fin d’études et chercher un stage pratique. Donc, la première cause, diriez-vous, est la crise économique aiguë que vit la France. Oui, mais pas que ça ! L’étudiant algérien est, en effet, soumis à une réglementation particulière. Contrairement à tous les étudiants étrangers, seuls les Algériens ne peuvent pas travailler avec un «récépissé de demande de carte de séjour», sur lequel est clairement mentionné : «n’autorise pas son titulaire à travailler».
Or, à titre d’exemple, les étudiants tunisiens et marocains, dans la même situation, n’ont pas cette notification et ne sont pas soumis à une autorisation de travail. Avant d’espérer trouver un emploi, il faut patienter encore deux mois, au minimum, pour l’obtention du fameux titre de séjour. Le malheur, c’est que même avec ce document, l’étudiant algérien tombe sous l’application d’un autre texte de loi, pour ainsi dire «discriminatoire». Le site officiel de l’administration française servicepublic.fr rapporte : «L’étudiant algérien reste soumis à autorisation s’il souhaite exercer un travail salarié à titre accessoire pendant ses études. L’autorisation est limitée à 50% de la durée annuelle du travail pour la branche professionnelle ou la profession concernée.» L’interprétation pratique de cette loi est que l’étudiant algérien doit demander une autorisation de travail auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
La délivrance de ce document est obligatoire avant le début de l’activité. Parmi les pièces à fournir, une promesse d’embauche ou un contrat de travail, précisant que le concerné ne va pas dépasser le nombre d’heures de travail, limité à 18 et une demi-heure par semaine (contre 21 heures pour les autres étudiants étrangers) pour un salaire équivalent généralement au SMIC. Au final, un étudiant algérien qui postule pour un poste de travail quelconque doit réclamer à son employeur potentiel un nombre limité d’heures et quelques jours d’attente avant l’obtention des documents nécessaires.
Dans la plupart des cas, sa candidature est rejetée au profit d’étudiants français ou autres. Il faut signaler, à ce stade, que quelques employeurs sont compréhensifs contrairement à la majorité d’entre eux.
La seule alternative qui reste serait le travail au noir, notamment à Paris. Nos étudiants qui ont «la chance» de connaître un employeur «généreux» ont intégré toute sorte de corps professionnels, les plus improbables vu leur parcours universitaire. On les retrouve dans les marchés, les chantiers, le nettoyage et plusieurs ont le «privilège» de travailler dans la restauration ou dans des agences de sécurité.
La difficulté de trouver un bon travail rémunérateur pénalise doublement les étudiantes. Elles se contentent de faire quelques heures de baby-sitting par semaine, travailler dans les marchés hebdomadaires, faire le ménage chez des particuliers ou, d’une manière très précaire, exercer dans le nettoyage industriel. Certaines, faute de trouver mieux, travaillent comme serveuse dans des restaurants ou dans des bars. Quelques-unes sont complètement désespérées qu’elles n’hésitent pas à offrir des prestations sexuelles payantes. Où sont les études dans tout ça ? Reléguées à un rang inférieur dans la hiérarchie des préoccupations.
Les plus pugnaces et persévérants continuent, tant bien que mal, leurs études. Pour ce faire, ils peuvent compter sur des crédits et le soutien financier de leur famille. Ils sollicitent aussi l’aide des associations caritatives, comme les restos du cœur.
Le constat et le diagnostic sont alarmants pour ne pas dire choquants. Penchons-nous, maintenant, sur les causes et les dessous de cette situation dérisoire des étudiants algériens et ses conséquences indésirables.